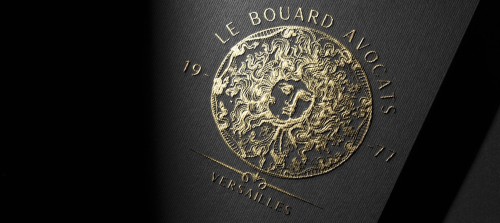Quel statut juridique choisir pour votre entreprise ?
Choisir la structure légale de votre entreprise est un vrai casse-tête au début. Plusieurs statuts sont envisageables, chacun avec ses propres règles, ses avantages et ses inconvénients aussi. Cet article vous explique les principales options, ce qu’elles impliquent et ce que cela change concrètement pour vous. L’idée est que vous repartiez avec une vue claire et assez d’informations pour choisir ce qui correspond le mieux à votre projet.

Le vol entre époux : que dit le Code pénal ?
Peut-on vraiment parler de vol entre mari et femme ? Cette question peut sembler paradoxale puisque le mariage implique une communauté de vie, souvent aussi de biens. Pourtant, des conflits conjugaux peuvent amener l’un des époux à s’accuser de vol : un retrait bancaire non autorisé, une disparition d’objets personnels inexplicable… Dans quelles conditions ces faits peuvent-ils être qualifiés pénalement de vol ? La réponse n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air.

Les allocations chômage sont-elles imposables ?
La question de l’imposition des allocations chômage suscite régulièrement des interrogations, tant chez les allocataires que chez les professionnels de la fiscalité. En effet, si ces prestations ont pour vocation de pallier la perte de revenus liée à une rupture d’emploi, leur traitement fiscal n’est pas pour autant exonéré de toute imposition. La fiscalité des revenus de remplacement, et en particulier des allocations chômage, répond à un ensemble de règles précises qu’il est indispensable de comprendre pour remplir correctement ses obligations déclaratives.

Cumuler ARE et création d’entreprise : comment ça marche ?
Lorsqu'un contrat de travail prend fin, à l'initiative de l'employeur, l'employé a droit à des indemnités de licenciement mais aussi, à des indemnités de chômage (ARE). Ces dernières étant destinées à permettre à la personne licenciée de subvenir à ses besoins, le temps de retrouver un emploi. Mais, cette période d'inactivité peut, au lieu d'être une période de recherche d'un autre contrat de travail, constituer le point de départ d'une aventure entrepreneuriale. Mais sera-t-il toujours possible de bénéficier des indemnités de licenciement dans ce cas ? Ou alors la personne concernée devra-t-elle y renoncer ? Cet article vise à apporter des réponses à ces questions.

Peut-on toucher le chômage après une démission ?
Dans l’imaginaire collectif, la démission est souvent perçue comme un motif d’exclusion automatique des droits au chômage. Pourtant, si la règle générale exclut effectivement le bénéfice de l’allocation chômage après une démission, il existe de nombreuses exceptions prévues par la réglementation, qui permettent à certaines personnes démissionnaires d’être indemnisées. Mais alors quelles sont ces exceptions ?

Radiation par France Travail : Quelles sont les voies de recours ?
Être radié de France Travail ou voir sa demande d'allocation refusée peut avoir des conséquences lourdes, surtout chez une personne déjà atteinte par la perte de son emploi. En ceci que ces situations ont un impact immédiat sur les revenus des personnes et l’accès à certains services. Toutefois, rien n'est encore perdu ! Les personnes concernées disposent de voies de recours pour faire valoir leurs droits. Mais quelles sont-elles ?

Trop-perçu de Pôle emploi : que faire ?
Le fait pour une personne de recevoir un courrier de Pôle emploi l'informant d’avoir perçu des sommes supérieures à celles auxquelles elle avait droit peut provoquer stress, incompréhension, voire colère. Alors qu'elle pensait avoir perçu légitimement ses droits, voilà qu’on lui réclame des centaines, parfois des milliers d’euros, à rembourser rapidement. Cette situation peut être source de stress et d’incompréhension, quelle qu'en soit la cause. Et, les sommes perçues à tort doivent en principe être remboursées. Mais alors, que faire dans une pareille situation ?

Calcul de l’allocation chômage : comment vérifier vos droits ?
La perte d’un emploi, qu’elle soit prévue ou soudaine, met au quotidien de nombreux employeurs dans une situation de stress. Cela soulevant des questionnements au sujet de la détention de potentiels droits au chômage et le calcul de ces derniers. C'est pourquoi il est important de connaître les conditions d’ouverture des droits, de comprendre le mode de calcul de l’allocation et d'utiliser les bons outils pour vérifier ses droits sont autant d'étapes essentielles. Voici un guide, pour vous aider à voir plus clair et à estimer vos droits à l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par Pôle emploi.

Conflit entre co-indivisaires : Quels sont les recours juridiques ?
L’indivision est une situation fréquente en droit civil, notamment à la suite d’une succession, d’un divorce ou d’un achat immobilier à plusieurs. Elle suppose que plusieurs personnes, appelées co-indivisaires, détiennent ensemble des droits de même nature sur un ou plusieurs biens. En théorie, cette gestion collective repose sur un accord entre les parties. Mais, cela n'empêche pas que les différends, de différentes natures, ne tardent pas souvent à émerger. Ces conflits, parfois latents, parfois ouverts, peuvent paralyser la gestion du patrimoine commun. Il existe heureusement plusieurs recours juridiques pour sortir de l’impasse, tout en respectant les droits de chacun.
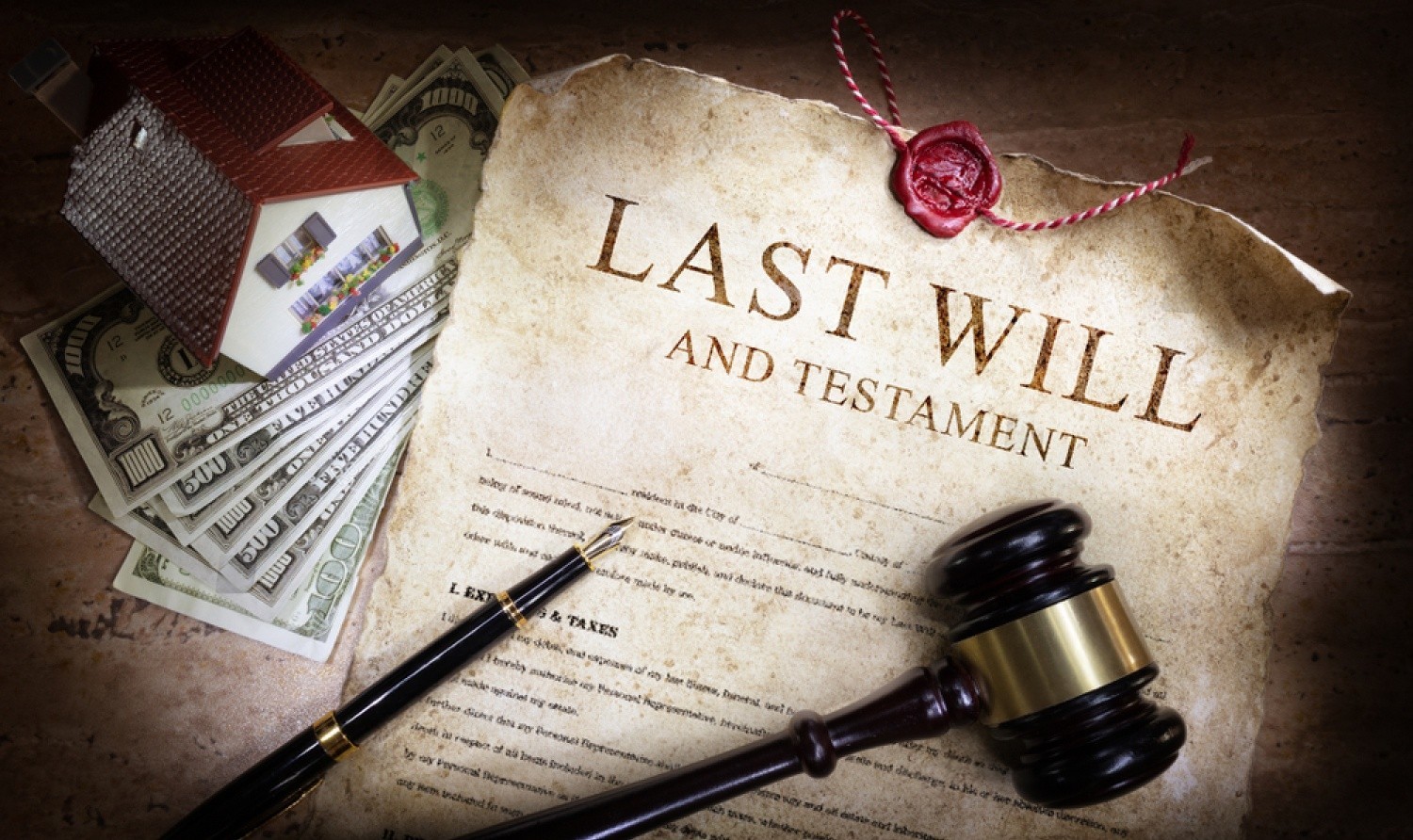
Héritage bloqué : que faire si un membre de la famille refuse de coopérer ?
Le décès d’un parent donne généralement lieu à une période de deuil, mais aussi, l'ouverture de la succession. Dans l’idéal, cette étape doit se dérouler dans le calme et la transparence, permettant à chaque héritier de recevoir sa part dans le respect des volontés du défunt et des dispositions légales. Mais il arrive que tout se complique : un héritier peut refuser de signer, retarder volontairement les démarches, s’opposer à la vente d’un bien indivis, ou contester les décisions des autres membres de la famille. Ce comportement, qu’il soit motivé par un désaccord réel, un sentiment d’injustice, ou par des conflits familiaux anciens, peut entraîner un blocage de la succession. Dans ce contexte, il devient essentiel de comprendre les recours possibles pour débloquer la situation, tout en préservant autant que possible l’équilibre familial.

Peut-on être poursuivi pour un prêt non remboursé à un parent ?
Les relations familiales sont souvent fondées sur la confiance, l’entraide et la solidarité. Il est courant qu’un parent prête de l’argent à un enfant ou, à l’inverse, qu’un enfant soutienne financièrement un parent dans le besoin. Toutefois, lorsque le remboursement d’un prêt tarde ou n’intervient jamais, cette relation de confiance peut se transformer en une situation conflictuelle. Le parent créancier peut alors se retrouver face à cette interrogation : peut-on poursuivre un proche pour un prêt non remboursé ?

Dois-je porter plainte contre mon conjoint pour vol de documents ?
La vie conjugale repose sur des liens affectifs, mais aussi sur une confiance mutuelle. Cependant, dans certaines situations, cette confiance peut être considérablement remise en question. Notamment en cas de prise non consentie ou la disparition de biens ou documents d'un des époux. Cet acte constitue une infraction, au sens de l'article 411-1 du Code pénal, quelle que soit la nature des biens objets de vol. Toutefois, la protection conférée par l'immunité familiale aux époux mariés, rend ces derniers pénalement irresponsables en cas de vol. Sauf restrictions, dans des cas bien définis !