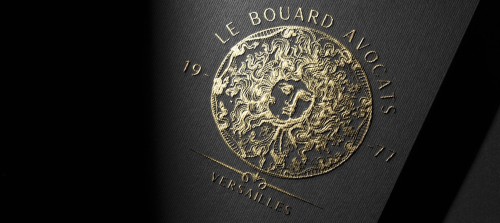Servitudes de passage et droit de propriété : comment les faire respecter ?
Dans bien des situations, les relations entre voisins peuvent se tendre autour d’un sujet sensible : l’accès à un terrain enclavé. Lorsqu’un propriétaire ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique, il peut bénéficier d’un droit de passage sur le terrain de son voisin, une situation qui peut rapidement devenir conflictuelle. Que faire lorsque ce droit n’est pas respecté ?

Cas de malfaçons : Quelle est la responsabilité du constructeur ?
Lorsqu’on fait construire une maison, la crainte des malfaçons est bien légitime. Une mauvaise exécution des travaux peut engendrer des coûts élevés et des désagréments importants. Heureusement, la loi encadre strictement la responsabilité du constructeur pour protéger les propriétaires. Quelles sont les garanties dont vous bénéficiez ? Quels sont vos recours en cas de problème ? Cet article vous éclaire sur les moyens de vous prémunir contre les malfaçons.

Permis de construire refusé : quels recours possibles ?
L'obtention d'un permis de construire représente une étape essentielle pour mener à bien un projet immobilier. Ce document délivré par la mairie atteste de la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Toutefois, il arrive que l’administration rejette une demande de permis de construire, ce qui peut retarder voir compromettre un projet. Dans ce cas, il est important de connaître les moyens pour contester cette décision.

Troubles de voisinage : quels recours en cas de nuisances ?
La cohabitation dans un immeuble, un quartier peut parfois virer au cauchemar. Entre le voisin qui écoute sa musique à fond, celui qui laisse aboyer son chien jour et nuit, ou encore celui qui fume sous vos fenêtres, les exemples de troubles de voisinage sont nombreux. Si certains peuvent sembler anodins, leur répétition ou leur intensité peut avoir de vraies conséquences sur la santé, le bien-être et la jouissance paisible d'un logement. Face à ces désagréments, la loi a prévu plusieurs moyens afin de garantir la sérénité des habitants au sein de leur logement.

Charges de copropriété : comment contester une augmentation abusive ?
L'augmentation des charges de copropriété peut devenir un véritable sujet de tension entre les copropriétaires et le syndic. Si certaines hausses sont justifiées par des travaux ou une réévaluation des coûts, d’autres peuvent sembler injustifiées, voire abusives. Face à une augmentation soudaine et importante, il est essentiel pour un copropriétaire de connaître ses droits, les procédures de contestation et les recours possibles. Cet article vous donne les étapes pour contester une hausse que vous jugez démesurée.

La colocation : que choisir entre le bail individuel et le bail solidaire ?
Face à l'augmentation des prix de l’immobilier, la colocation séduit un nombre croissant de locataires en France. Étudiants, jeunes actifs ou même seniors s’orientent vers cette formule qui permet de partager un logement, mais aussi les charges, dans un esprit de vie collective. Pourtant, au moment de signer, une question cruciale se pose : faut-il opter pour un bail individuel ou pour un bail solidaire ? Ces deux options engendrent des conséquences juridiques et financières très différentes. Il est donc essentiel d’en comprendre les spécificités avant de s’engager.

Expulsion d’un locataire : quelles sont les étapes légales ?
L’expulsion d’un locataire est une démarche qui ne peut être réalisée sans respecter une procédure légale stricte. En France, la législation protège les locataires contre les expulsions abusives, imposant aux bailleurs des obligations précises avant d’engager une telle procédure. L’expulsion peut être motivée par des impayés de loyers ou d'autres raisons valables. Toutefois, elle ne peut intervenir qu’après plusieurs étapes incontournables et sous le contrôle des autorités judiciaires.

Les travaux réalisés dans une location : qui paie quoi entre le bailleur et le locataire ?
Dans le cadre d'une location, que vous soyez locataire pour la première fois ou un habitué, une chose est sûre : tôt ou tard, des pannes s’invitent dans votre quotidien. Une fuite dans la cuisine, une chaudière en panne, un volet cassé… La réaction immédiate est souvent d’agir vite et de vouloir tout régler soi-même pour éviter toute gêne. Pourtant, vous n’avez pas à tout payer ! Entre ce qui relève de l'entretien courant et ce qui relève de la responsabilité du bailleur, il existe une répartition légale très claire. De ce fait, bien la connaître, c’est être en capacité de faire respecter ses droits et d'éviter des mauvaises surprises.

Fin de bail locatif : quels sont les droits du locataire en France ?
La rupture d'un bail locatif, que ce soit par volonté du locataire ou du propriétaire, soulève toujours des questions pratiques et juridiques. Beaucoup de locataires ignorent ce à quoi ils ont droit à l’approche de la fin du contrat de location, ce qui peut parfois conduire à des erreurs ou à des conflits. Pourtant, le Code civil et la loi du 6 juillet 1989 encadrent de manière précise cette période de transition. Cet article présente les droits du locataire au terme de son bail.

Délai de rétractation en immobilier : comment fonctionne-t-il ?
L’achat d’un bien immobilier constitue une étape majeure dans la vie d’un particulier. Qu’il s’agisse d’un premier investissement, d’un changement de résidence ou d’un placement patrimonial, cette décision est lourde de conséquences. Pour protéger les acheteurs face à la complexité des transactions et à l’enjeu financier qu’elles représentent, la législation française a instauré un droit de rétractation. Ce droit permet de revenir sur sa décision dans un certain délai, sans justification ni pénalité. En 2025, ce dispositif reste un pilier fondamental de la protection des acquéreurs, mais il s’accompagne de règles précises qu’il convient de bien comprendre.

L'achat d'un bien immobilier : quels impacts pour l’acquéreur ?
En France, l'accès à la propriété représente un objectif majeur pour de nombreux ménages. Pourtant, en 2024, seulement 57 % des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale, un chiffre en légère baisse par rapport à 2014. Cette régression se justifie par les défis croissants auxquels les acquéreurs potentiels sont confrontés, notamment l'augmentation des prix de l'immobilier, les conditions d'emprunt plus strictes et les charges fiscales associées. Ainsi, l'achat d'un bien immobilier ne se limite véritablement pas à une simple transaction financière, il entraîne des répercussions significatives sur plusieurs plans de la vie quotidienne des acheteurs. Il est donc essentiel de pouvoir comprendre ces impacts afin de prendre une décision éclairée et adaptée à sa situation personnelle.

Construction et urbanisme : réglementation et bonnes pratiques
En 2025, le secteur de la construction en France fait face à des mutations profondes. Entre exigences environnementales renforcées, nouvelles normes techniques, lutte contre l'artificialisation des sols et attentes sociétales accrues, construire ne se limite plus à ériger un bâtiment. C’est désormais un acte responsable, réglementé et stratégique. Les professionnels du bâtiment, les promoteurs immobiliers, les collectivités, mais aussi les particuliers doivent s’adapter à une réglementation de plus en plus exigeante, encadrée par des lois récentes et orientée vers un objectif central : concilier le développement urbain et la transition écologique. Cet article vous présente de manière claire les grandes règles applicables à la construction en 2025, ainsi que les enjeux actuels de ce secteur.